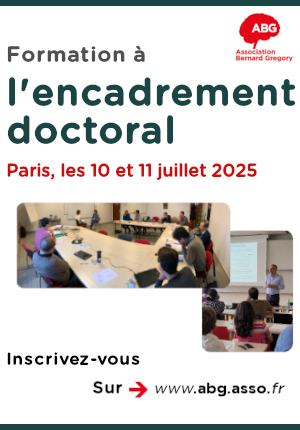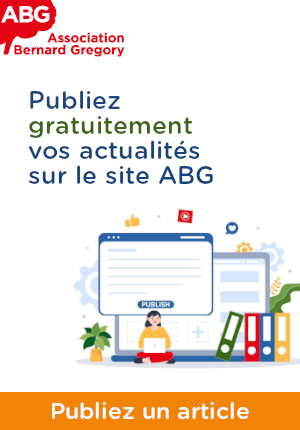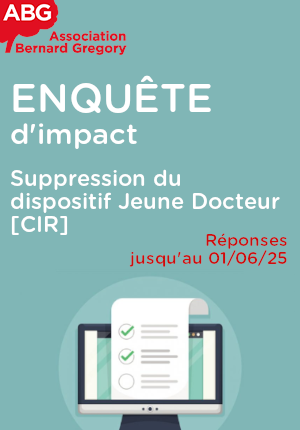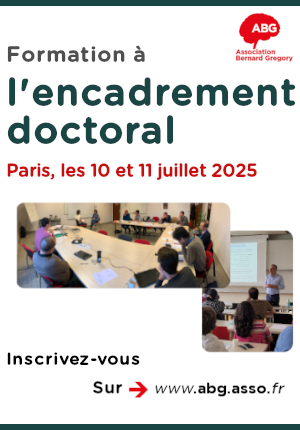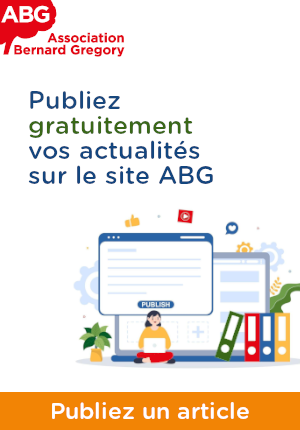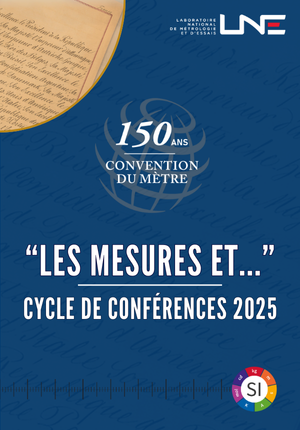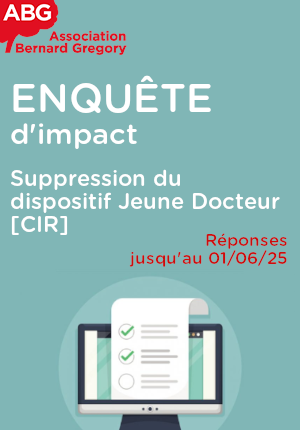Influence de la nutrition postnatale sur l'orientation phénotypique des cardiomyocytes
| ABG-130048 | Thesis topic | |
| 2025-03-26 | Public funding alone (i.e. government, region, European, international organization research grant) |
- Biology
- Health, human and veterinary medicine
Topic description
Le cœur, dont les battements sont intimement attachés à la notion de Vie, est un muscle dont la fonction est sous-tendue par des cellules contractiles appelées cardiomyocytes. Il est généralement admis que les cardiomyocytes sont des cellules « terminalement différenciées » ce qui implique que leur capacité à proliférer ou à se régénérer en cas d’atteinte est extrêmement limitée. Par conséquent, le nombre de cardiomyocytes d’un cœur adulte est déterminé dès la prime enfance, et toute perte de ces cellules, lors d’un infarctus du myocarde ou du développement d’une insuffisance cardiaque, est considérée comme irrémédiable. Ainsi, les évènements susceptibles de modifier le nombre ou la fonctionnalité des cardiomyocytes dans des étapes-clefs du développement revêt une importance majeure dans la survenue de maladies cardiaques à l’âge adulte.
Au cours de la gestation, le cœur se développe grâce à la différenciation de cellules progénitrices et à l’importante prolifération de cardiomyocytes fœtaux1. Après la naissance, l’environnement du nouveau-né change drastiquement, notamment d’un point de vue du taux d’oxygène tissulaire, ce qui favorise alors la hausse d’utilisation des acides gras plutôt que des glucides comme principale source énergétique au sein du myocarde. Ce shift métabolique s’accompagne d’un changement dans le développement cardiaque postnatal, car les cardiomyocytes passent d’une croissance hyperplasique vers une croissance hypertrophique2. Ainsi, chez les mammifères, une courte fenêtre proliférative des cardiomyocytes persiste durant les premiers jours de vie postnatale3. Par conséquent, les conditions environnementales, notamment nutritionnelles, au cours de la période postnatale immédiate pourraient « conditionner » le nombre de cardiomyocytes présents dans le cœur. En outre, l’utilisation des substrats métaboliques, glucidiques et lipidiques par le cœur joue un rôle majeur sur le statut prolifératif des cardiomyocytes4, 5. Cependant, peu de travaux à ce jour ont exploré l’influence de la nutrition postnatale sur la capacité des cardiomyocytes à proliférer après la naissance, et évalué leur sensibilité à des changements d’environnement métabolique.
Au laboratoire PEC2, un modèle de suralimentation postnatale (SAPN) chez le rongeur a été développé, qui repose sur la réduction de la taille de la portée à la naissance6. Ce modèle conduit à des changements nutritionnels précoces au travers de l’augmentation de l’accès au lait maternel dès les premiers jours de vie, menant notamment au développement d’une surcharge pondérale ainsi qu’à une hypertrophie cardiaque précoce7. Ce phénotype touche à la fois les mâles et les femelles, même si certaines différences sont observées selon le sexe des individus (données en cours de publication). A l’âge adulte, les souris soumises à une SAPN développent une intolérance au glucose associée à une résistance à l’insuline mais également une altération de la fonction cardiaque8, 9 et une sensibilité plus importante aux lésions d’ischémie-reperfusion que des souris témoins10-12.
Des données récentes de notre laboratoire ont montré que, seulement quelques jours après la naissance, la SAPN entrainait une réduction de la prolifération postnatale des cardiomyocytes dans le cœur de nouveau-nés. Ainsi, au moment du sevrage, le cœur des souriceaux présentait un nombre réduit de cardiomyocytes (données non publiées). En plus d’être un modèle pertinent et original de syndrome métabolique, le modèle de SAPN altèrerait de façon précoce la composition et la structure cardiaque. Toutefois, nous ne savons pas aujourd’hui par quels mécanismes le cœur de souris nouveau-nées peut voir sa structure modifiée par les conditions de nutrition postnatale.
Afin de comprendre l’origine des altérations cardio-métaboliques observées chez les souris SAPN adultes, mâles et femelles, notre objectif sera d’étudier les conséquences d‘une SAPN sur la prolifération postnatale des cardiomyocytes de souriceaux à différents âges postnataux. Nous souhaitons explorer les mécanismes mis en jeu, notamment d’ordre métabolique, qui pourraient expliquer ces changements, ce qui nous permettra de déterminer certains candidats susceptibles de ralentir ou d’accroitre la fenêtre proliférative des cardiomyocytes.
Les deux objectifs de notre projet seront de :
1 - Etudier l’impact de la SAPN sur la fenêtre proliférative et le nombre de cardiomyocytes chez des souriceaux mâles et femelles à différents âges et explorer les mécanismes métaboliques impliqués. Pour ce faire, des souris néonatales soumises à une SAPN seront étudiées à différents âges (7, 10 et 24 jours de vie). Après prélèvement du cœur, différents marqueurs de prolifération cellulaire (Ki67, Aurora B kinase) seront étudiés histologiquement pour mettre en évidence la capacité proliférative des cardiomyocytes. A chaque âge, les cardiomyocytes seront isolés, comptés et une analyse de l’expression de protéines et gènes impliqués dans la prolifération (Ki67, cyclines, …), l’apoptose cellulaire (Bax, Bcl-2, caspases, …) ou encore l’hypertrophie (ANF, Myh7, …) sera réalisée. Une analyse lipidomique sera entreprise à un temps précoce (PN7) sur le plasma, le lait maternel, le tissu cardiaque et les cardiomyocytes isolés, afin de déterminer des candidats métaboliques susceptibles d’influer sur la capacité des cardiomyocytes à proliférer.
2 - Restaurer le taux de prolifération postnatale des cardiomyocytes chez les souris par une intervention nutritionnelle à visée thérapeutique. Ainsi, Suite à l’analyse lipidomique, les meilleurs candidats métaboliques susceptibles d’allonger ou de raccourcir la fenêtre proliférative seront mis en culture avec des CM postnataux isolés de cœurs de souriceaux. Des analyses de biologie moléculaire et tissulaire permettront d’observer leurs effets sur le nombre et la prolifération des CM mis en culture. Ces premiers travaux permettront par la suite d’envisager une thérapie nutritionnelle sur le long terme, et d’en explorer les effets sur la fonction cardiaque et la sensibilité des cœurs à une ischémie-reperfusion cardiaque, mimant l’infarctus du myocarde, chez des animaux âgés de 6 à 12 mois, âge mature chez la souris, plus cohérent avec celui de l’apparition des MCV chez l’humain.
Starting date
Funding category
Funding further details
Presentation of host institution and host laboratory
Université de Bourgogne Europe - DIJON
Laboratoire d'accueil : PEC2
Candidate's profile
Connaissances et compétences requises
Les connaissances suivantes sont requises :
- Physiologie, physiopathologie du système cardiovasculaire
Les compétences techniques suivantes sont souhaitées :
- Biochimie, PCR, Western Blot
- Expérience préalable de l’expérimentation animale : intérêt pour la chirurgie du petit animal
Les qualités suivantes seront appréciées :
- Maîtrise correcte du français et/ou de l’anglais, oral et écrit
- Capacités d’organisation du travail, autonomie, ponctualité, sérieux, rigueur expérimentale
- Sens du travail en équipe
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Get ABG’s monthly newsletters including news, job offers, grants & fellowships and a selection of relevant events…
Discover our members
 Institut Sup'biotech de Paris
Institut Sup'biotech de Paris  CASDEN
CASDEN  TotalEnergies
TotalEnergies  Nokia Bell Labs France
Nokia Bell Labs France  ONERA - The French Aerospace Lab
ONERA - The French Aerospace Lab  ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège
ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège  CESI
CESI  Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE  Tecknowmetrix
Tecknowmetrix  ANRT
ANRT  SUEZ
SUEZ  PhDOOC
PhDOOC  Groupe AFNOR - Association française de normalisation
Groupe AFNOR - Association française de normalisation  Ifremer
Ifremer  Aérocentre, Pôle d'excellence régional
Aérocentre, Pôle d'excellence régional  MabDesign
MabDesign  MabDesign
MabDesign  Généthon
Généthon  ADEME
ADEME