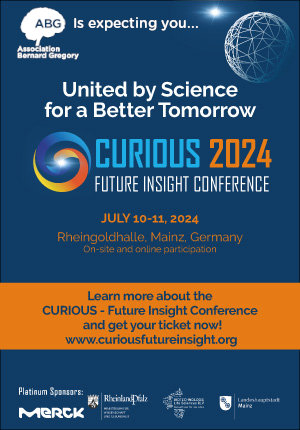Étude de l’influence des conditions de brasage sur la tenue mécanique en service de jonctions céramique - métal
| ABG-123986 | Sujet de Thèse | |
| 18/05/2024 | Cifre |

- Matériaux
- Génie des procédés
- Sciences de l’ingénieur
Description du sujet
Contexte
Dans un contexte d’extension croissante des réseaux et des équipements électriques, la protection électrique des équipements est devenue une préoccupation majeure. Les SPD (Surge Protective Device) incluent différents composants : varistances à oxyde de zinc, diodes, éclateurs à air, éclateurs à gaz, etc. Développés dans les années 60 et utilisés principalement en protection sur les réseaux téléphoniques jusque dans les années 90, les éclateurs à gaz sont aujourd’hui utilisés également sur les réseaux électriques basse tension mais avec des caractéristiques de design (forme et taille) et de tenue électrique (niveau de choc) très différentes qui induisent des problématiques nouvelles.
Un éclateur à gaz (GDT pour Gas Discharge Tube) est un composant obtenu après le scellement sous atmosphère contrôlée d’une céramique isolante et de deux électrodes métalliques. En fonctionnement normal, le gaz n’est pas ionisé et le GDT est isolant. Si une tension critique (supérieure à un seuil fixé) est appliquée aux bornes des électrodes, le gaz va s’ioniser, le GDT deviendra conducteur et le courant généré lors de la surtension pourra s’écouler vers la terre au lieu de détruire l’équipement.
Le scellement du GDT, c’est-dire l’assemblage de ses parties métalliques et céramique, est un point critique du procédé de fabrication. La maîtrise et l’optimisation de cette étape sont essentielles pour obtenir les performances électriques optimales (tensions d’amorçage, tenue aux chocs sur onde de courant, etc.) [1] ainsi qu’une diminution notable du coût final du produit (amélioration des rendements, utilisation d’électrodes monobloc par exemple). Parallèlement, les innovations recherchées visent à une réduction des coûts énergétiques associés à la production et au respect des exigences environnementales et de santé pour le choix des matériaux constitutifs, notamment les directives RoHS (Restriction of Hasardous Substances in electrical and electronic equipment) limitant l’emploi de certains alliages ou composés.
Problématique de recherche
L’association de matériaux métallique et céramique s’opère par brasage haute température. L’adhésion entre les matériaux de base se fait à l’aide d’un métal d’apport (brasure) qui, porté à l'état liquide durant le process, vient mouiller les interfaces des substrats puis se solidifie lors du refroidissement venant créer la liaison d’ensemble [2,3]. La différence entre les coefficients de dilatation des substrats induit lors de ce process d’importantes contraintes résiduelles au sein de la structure assemblée. Ces contraintes modifient le comportement des matériaux et peuvent générer des microfissures au sein de la céramique, de la brasure ou aux interfaces entre les phases [4,5]. De tels phénomènes sont à l’origine de pertes d’intégrité des assemblages finaux ou à une réduction de leur durée de vie. La fabrication d’un GDT nécessite plusieurs opérations de brasage (i) celui de l’électrode en cuivre sur une coupelle Fe-Ni, (ii) celui de l’assemblage ainsi obtenu sur une céramique isolante à base d’alumine. La maîtrise de ces étapes de fabrication passe par l’optimisation de divers paramètres tels que la conception des pièces, la préparation des surfaces ou encore les conditions de scellement (cycles thermiques, contrôle de l’atmosphère, etc.). La connaissance des relations entre procédés, microstructures et propriétés qui en résultera servira à l’établissement de modèles empiriques afin d’améliorer le design des nouveaux produits et de réduire la durée de leur développement.
La thèse proposée a pour premier objectif de caractériser du point de vue métallurgique l’assemblage entre la douille céramique et l’électrode métallique en alliage N42 (alliage Fe-Ni à dilatation contrôlée couramment utilisé pour le scellement céramique/métal) [6]. Ce travail permettra d’approfondir la connaissance sur les contraintes thermomécaniques des assemblages et leur impact sur la conception des différents composants. Il s’agira notamment d’établir le comportement et les propriétés de la brasure selon les préparations de surface des pièces à assembler et selon le (ou les) flux utilisé(s) pour réduire les impuretés (oxydes et inclusions).
Dans un second temps, une étude de fabrication alternative sera menée afin de braser des électrodes monobloc en cuivre directement sur la céramique. Cette démarche innovante permettrait de diminuer le coût des produits par la suppression d’une étape de brasage et l’utilisation d’une seule pièce métallique. Les enjeux scientifiques associés sont liés aux qualités des interfaces générées, à leurs microstructures et aux gradients de propriétés ainsi qu’à la durabilité des assemblages sous sollicitations thermomécaniques. Si les premiers points sont relativement bien étudiés [7], les performances en termes de durabilité sont encore mal connues dans le cadre des applications de protection électrique envisagées [8]. En particulier, il sera intéressant à ce stade d’accorder une attention particulière à l’emploi de brasures réactives, qui visent à associer en une seule étape la préparation des surfaces et la jonction mais qui ne sont pas encore maîtrisées sur le plan industriel. L’analyse comparative de solutions existantes [9] permettra de sélectionner les options les plus pertinentes pour la configuration et les exigences spécifiques des éclateurs.
Bibliographie
[1] Gannac Y., Leduc G., Pham C.D., Crevenat V., 8/20 and 10/350 surges behaviour of a Gas Discharge Tube according to gas pressure, Electric Power System Research 197 (2021), 107302.
[2] Ferjutz K., Davis J.R., Wheaton N.D., ASM Handbook Volume 06, Welding, Brazing, and Soldering, 1993.
[3] Macel D., Brasage - Définitions et exemples, Techniques de l’ingénieur, 2024.
[4] Cazajus V., Approches numérique et expérimentale de la liaison céramique métal réalisée par brasage en vue de la création d’un outil d’aide à la conception, thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Toulouse, 2007.
[5] Yi R., Chen C., Shi C., Li Y. Li H., Ma Y., Recent advances in residual thermal stress of ceramic/metal brazes, Ceramics International 47 (2021), 20807-20820.
[6] Mengelle A., Proposer une alternative à l’électrode en Cuivre dans les éclateurs à gaz, Mémoire de Master Recherche, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, 2023.
[7] Kozlova O., Brasage réactif Cu/acier inoxydable et Cu/alumine, thèse de doctorat, Institut Polytechnique de Grenoble, 2008.
[8] Feng, J., Herrman M., Reinecke A.-M., Hurtado A., Active brazing for energy devices sealing, Journal of Experimental and Theoretical Analysis 2 (2024) 1–27.
[9] Tillmann W., Anar N.B., Wojarski L., Mechanical behavior of reactive air brazed (RAB) Crofer 22 APU-Al2O3 joints at ambient temperature. SN Applied Science 2 (2020) 809.
Actions à mener
La première étape consistera à réaliser une étude bibliographique axée sur les différents alliages de brasure mis en œuvre pour assembler des alliages métalliques (Fe-Ni et/ou Cu) sur une céramique (Al203) et les effets des paramètres de brasage sur le comportement des jonctions. Cette étude permettra de définir les alliages de brasure compatibles RoHS, de cerner les problèmes généralement rencontrés dans ces procédés et de définir les types d’essais et modèles d’éprouvettes permettant de caractériser la qualité et les performances des assemblages. Durant cette première phase, le(la) doctorant(e) s’initiera aussi aux différentes techniques de préparation des échantillons, d’observation et de caractérisation des microstructures ainsi que les différentes techniques d’essais mécaniques. Cette formation sera réalisée sur les assemblages brasés actuellement produits par CITEL, fournissant ainsi une base de référence à l’ensemble de la thèse qui pourra être comparée par la suite aux nouvelles solutions proposées.
La deuxième étape concerne l’étude des effets des paramètres de fabrication (variables machine, matière et forme des éprouvettes) sur les caractéristiques des produits obtenus. Elle sera réalisée selon différents types et conditions d'essais et menée sur des alliages de brasure différents. Ces essais seront réalisés sur des éprouvettes de géométries normalisées mais aussi spécifiques non standards. Un des objectifs est de tenter, dans un premier temps, de relier les mécanismes de dégradation avec les résultats des caractérisations métallurgiques effectuées et les paramètres de brasage. Ces travaux tenteront d’expliquer et de comprendre les liens existants entre les phénomènes métallurgiques spécifiques aux brasures considérées et les mécanismes de dégradation des propriétés mécaniques.
A partir des éléments acquis lors des deux premières étapes, les objectifs de la troisième étape seront :
• de proposer des règles de conception, de fabrication et de finition des éprouvettes propres à tester et valider les conditions de fabrication des composants en fabrication (au stade de la mise au point, de la qualification et de la production) ;
• d’établir une modélisation phénoménologique fiable expliquant les effets propres de chaque paramètre matériau et de fabrication sur les performances métallurgiques et mécaniques des éprouvettes et composants. Cet outil permettra de définir avec précision les critères de conception les plus pertinents ainsi que les conditions optimales de traitement thermique industriel post fabrication.
Organisation et conditions de la thèse
Le travail sera mené en collaboration entre les équipes de recherche de l'entreprise CITEL à Reims (Marne) et du LGP à Tarbes (Hautes Pyrénées). Des périodes d’alternance entre les deux sites sont prévues suivant les phases du projet et l’avancement du travail.
L’étudiant se familiarisera avec la problématique industrielle sur le site de CITEL Reims pendant une période de deux mois environ. Il passera ensuite une longue période au laboratoire pour se former scientifiquement, et constituer une bibliographie sur le sujet. Lors des phases d’élaboration et de caractérisation des solutions développées, il sera amené à se déplacer ponctuellement sur le site rémois de CITEL, mais aussi potentiellement dans d’autres centres de recherche et de transfert pour des analyses spécifiques, non-disponibles sur les sites des partenaires. Enfin, il séjournera plus longuement chez CITEL lors de la campagne de validation finale de cette étude, en toute fin de thèse.
Le(la) doctorant(e) bénéficiera d’un contrat de travail d’une durée de 36 mois comprenant :
– un salaire brut annuel de 27 300€ sur 13 mois,
– une prime d’intéressement liée au site de REIMS au bout de 5 mois,
– une mutuelle et prévoyance d’entreprise,
– des tickets restaurant,
– une indemnité de transport,
– des activités sociales et culturelles du site de Reims.
Les frais de déplacement et d’hébergement sur Reims sont pris en charge par CITEL.
Prise de fonction :
Nature du financement
Précisions sur le financement
Présentation établissement et labo d'accueil
CITEL (https://citel.fr) est un groupe français à caractère international de 450 personnes dont 100 en France, numéro
trois mondial dans le domaine des protections contre les surtensions transitoires, notamment celles générées par la foudre.
L'entreprise fabrique deux types de produits essentiels et complémentaires :
- Les éclateurs à gaz (ou parasurtensions) qui sont des composants passifs du type « tube de décharge à gaz rare ». Ceux-ci sont placés sur les réseaux de télécommunication.
- Les parafoudres (ou dispositif de protection contre les surtensions transitoires) sont des sous-ensembles, associant plusieurs composants de protection. Ils sont intégrés aux installations afin de protéger tous les équipement électriques, électroniques ou informatiques des surtensions transitoires.
Le groupe CITEL est présent à l’international avec différentes filiales à travers les continents. Il possède deux usines de production, la première historique à Reims en France et la seconde à Shanghai, Chine.
L’Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées (UTTOP, www.uttop.fr) est la 4ème Université de Technologie de France. Située à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, ce nouvel établissement regroupe l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (l'ENIT) et l’IUT de Tarbes.
L'UTTOP revendique une architecture Formation/Recherche/Innovation intégrée, riche de l’écosystème développé par l’ENIT et l’IUT. L'UTTOP a pour ambition de développer l’offre de formation à tous les niveaux (licence, master, doctorat et titre d’ingénieur) au service du territoire mais aussi dans une logique de rayonnement national et international, en complémentarité avec les politiques menées par l'Université de Toulouse. L'UTTOP s’appuie sur une stratégie de recherche construite autour de trois enjeux sociétaux, portés par une ambition de rayonnement international :
- Accompagner les transitions environnementales par des approches éco-responsables,
- Préparer l'industrie du futur centrée sur l'innovation pour accompagner la transition industrielle,
- Oeuvrer à la mise en place de nouveaux modes d'organisation pour une société résiliente au service de l'humain.
Créé en 1989, le Laboratoire Génie de Production (LGP) est un laboratoire de l’UTTOP, dans lequel sont accueillis 55 enseignants-chercheurs. Le LGP accueille également 62 doctorants, inscrits dans cinq écoles doctorales partagées par les établissements de la Comue UFTMiP. Le LGP est un laboratoire pluridisciplinaire qui développe des activités de recherche autour des matériaux, de la mécanique, de l'automatique, de l'informatique, du génie électrique, de la robotique et des sciences et techniques de production dans le champ des Sciences et de l'Ingénierie des Systèmes. Les recherches sont menées le plus souvent en lien étroit avec des problématiques réelles du monde socio‐économique dans le cadre des trois enjeux sociétaux de l'Université de Technologie de Tarbes. Le LGP s’appuie sur des équipements remarquables, cohérents avec le besoin des entreprises et le profil des ingénieurs formés sur le site tarbais. La thèse proposée s'inscrit dans le cadre du Département scientifique « Mécanique-Matériaux-Procédés » du LGP et plus précisément au sein du groupe de recherche « Métallurgie Mécanique Structures enDommagement » qui s'intéresse tout particulièrement à la caractérisation et à la modélisation du comportement des matériaux et des structures survenant au cours du procédé de fabrication ou en service.
Site web :
Intitulé du doctorat
Pays d'obtention du doctorat
Etablissement délivrant le doctorat
Ecole doctorale
Profil du candidat
Le (la) candidat(e) devra être issu(e) d’une formation scientifique de niveau Master spécialisée dans le génie des matériaux et des procédés de mise en forme, ou de formation généraliste avec une dominante en sciences des matériaux. Des connaissances en génie électrique, mêmes élémentaires seront appréciées. Outre des qualités techniques à attester, le (la) candidat(e) devra posséder une curiosité scientifique pour aborder les différentes étapes proposées, mais aussi être force de propositions dans le déroulement de l’étude. Le (la) candidat(e) devra également posséder un bon niveau de maîtrise de l’anglais et du français et des qualités de synthèse écrites et orales.
Pour le(la) doctorant(e) qui sera recruté(e), cette thèse constituera une opportunité de monter en compétences dans les domaines de la protection électrique, de l’assemblage multi-matériaux par brasage et du comportement mécanique des alliages métalliques et des céramiques. Ce projet lui permettra également d’aborder et maîtriser de nombreuses techniques de caractérisation (métallurgique, mécanique et électrique) et lui offrira la possibilité de travailler dans un environnement collaboratif entre une entreprise et un laboratoire de recherche académique. La valorisation des résultats du travail au travers de la participation à des conférences et la rédaction d’articles scientifiques développera enfin ses capacités pédagogiques et de communication en français et anglais.
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Vous souhaitez recevoir nos infolettres ?
-
EmploiCDIRef. ABG124374Inn'PulseMassy Palaiseau / Paris 15ème - Ile-de-France - France

Jeune Docteur, Chef/fe de projet R et D électronique
ElectroniqueNiveau d'expérience indifférent -
EmploiCDIRef. ABG123897Université Catholique de l’Ouest (UCO)Angers - Pays de la Loire - France

Maître de conférences en Droit des affaires ou Sciences de Gestion ou en Sciences économique
Droit, science politique, géopolitique - Economie et gestionNiveau d'expérience indifférent -
EmploiCDIRef. ABG123642Laboratoire des Courses Hippiques (GIE LCH)Verrières-le-Buisson - Ile-de-France - France

Chargé(e) de Recherche et Innovation (H/F) / Senior Scientist Research & Innovation (M/F)
Chimie - BiochimieConfirmé