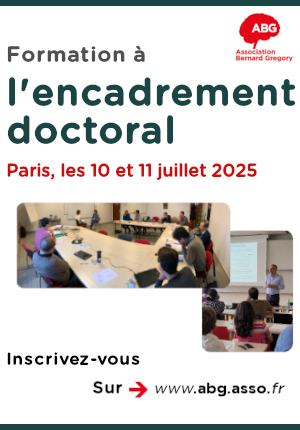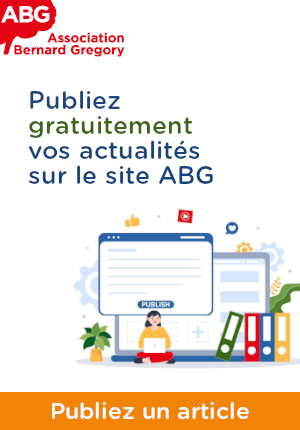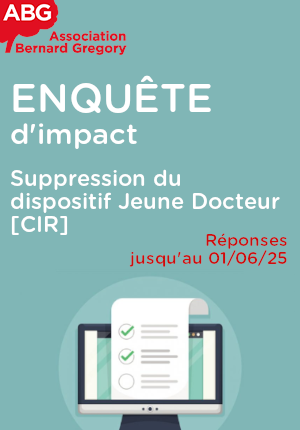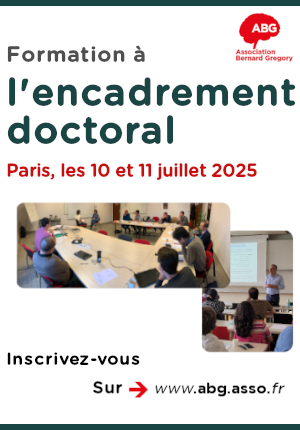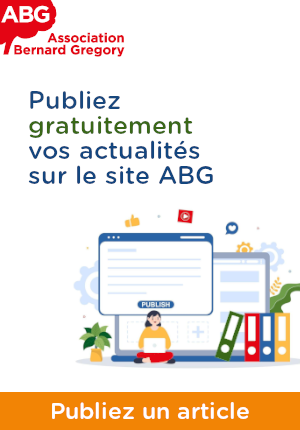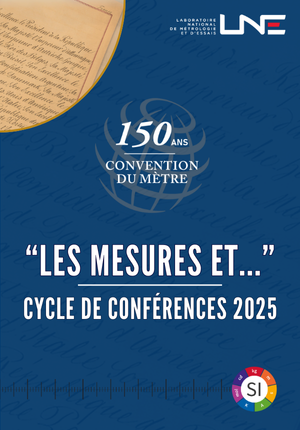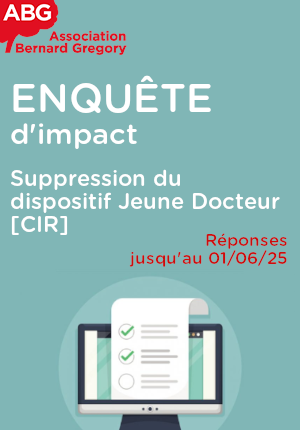utilisation de l’IA et de modèles de transfert hydrosédimentaire pour la compréhension de la recharge des aquifères de la craie normande et la protection de l’eau potable
| ABG-131833 | Sujet de Thèse | |
| 12/05/2025 | Contrat doctoral |
- Terre, univers, espace
- Science de la donnée (stockage, sécurité, mesure, analyse)
- Sciences de l’ingénieur
Description du sujet
La grande majorité des usages en eau sur le bassin versant de la Seine Aval et affluents côtiers est liée aux eaux souterraines que ce soit pour l’agriculture, l’industrie ou la production d’eau potable. Cette zone regroupe 7 masses d’eau souterraine (MESO) soumises à des contextes pédoclimatiques diversifiées, des enjeux, pressions et usages différents avec des degrés de vulnérabilités quantitatives et qualitatives variés. Néanmoins, le schéma géomorphologique et fonctionnel de l’ensemble de la zone est considéré comme uniforme avec des aquifères plus ou moins puissants sous couverture loessique suivie de résidus à silex. Seul un degré de karstification plus ou moins fort des aquifères entraine une variabilité dans la compréhension du fonctionnement hydrogéologique local des masses d’eau. Ainsi les 7 MESO de la zone sont considérées comme des aquifères libres dans la craie crétacée plus ou moins karstifiée.
Le premier questionnement que pose ce schéma réside dans le caractère libre de l’aquifère. Comment pouvons-nous le considérer comme tel alors même qu’il y a une formation argileuse parfois atteignant plus d’une dizaine de mètres d’épaisseur ? Des essais de perméabilité basés sur des tests en plein champs ou des mesures de perméamétries attestent d’une perméabilité inférieure à 10-7m.s-1 mais les bilans hydriques et l’étude de la variabilité piézométrique attestent de l’existence d’une recharge saisonnière, annuelle et pluriannuelle (Massei et al, 2019, Baulon et al, 2022a,b,2024). Plusieurs études hydrogéophysiques et prospections de terrain ont montré le caractère hétérogène (de par les silex plus ou moins nombreux) et discontinu (de par une épaisseur variable) de cette couche d’argile, notamment à travers l’existence de zone d’infiltration concentrée dans des pertes situées en surface ou en sub-surface (Jardani et al., 2006a,b,2007, 2008). Aujourd’hui la recharge des aquifères dans les MESO de la zone Seine-aval est considérée comme uniforme par infiltration diffuse continue lors des pluies efficaces. Selon cette hypothèse, les impacts du changement climatique sur la recharge des MESO sont calculés comme un report uniforme de l’altération de la pluie efficace. Pour autant, en intégrant la variabilité spatiale de l’épaisseur de la couche argileuse et le nombre de zone d’infiltration concentrée dans des pertes, il est possible d’intégrer une recharge différentielle et donc des impacts quantitatifs et qualitatifs, au regard des pressions, géographiquement différents sur les MESO.
Ainsi le projet se propose de revisiter les impacts du changement climatique et des pratiques agricoles sur la recharge des MESO selon 3 modèles : discontinus par les seules zones d’infiltration préférentielles puis épikarstiques en étendant ces zones préférentielles au drainage différé d’aquifères de sub-surfaces en comparaison du modèle actuel continu et diffus. L’objectif de la proposition vise à réaliser des diagnostics territoriaux de l’évolution de la disponibilité à l’horizon 2050 à l’échelle des 7 MESO de Seine-Maritime et de l’Eure. Ce projet est décomposé en 3 questionnements structurant :
T1 : Comment se fait la recharge de l’aquifère libre de la craie sous couverture imperméable d’argile à silex?
T1.1 confrontation des modèles conceptuels de la recharge
Actuellement la recharge est considérée comme un processus diffus continu à l’échelle de la craie normande. Plusieurs travaux ont montré que les conditions hydrogéomorphologiques contrastées impactent plus ou moins fortement les conditions de recharge à l’échelle globale mais le modèle régional de processus diffus-continu n’est pas remis en cause. Nous proposons d’utiliser 3 modèles basés sur le bilan hydrologique : EROS (modèle hydrologique semi-global), GARDENIA (modèle hydrologique global à réservoir), WATERSED (modèle de transfert hydrosédimentaire pour calculer les flux entrants dans les zones d’infiltration concentrée) pour modéliser la recharge à l’échelle des 7 MESO de Seine-Maritime et de l’Eure. Ces modèles seront calés sur les bilans hydrologiques (pluie efficace vs variations piézométriques des données disponibles à Météo France et au BRGM). Les résultats seront interprétés à l’aune des conditions hydrogéomorphologiques (puissance de l’aquifère, épaisseur zone non saturée, épaisseurs de formations superficielles loessiques et argileuses, contexte morphostructural) pour vérifier la plausibilité des ordres de grandeur des lames d’eau infiltrées par MESO.
T1.2 Analyse comparative de 3 modèles conceptuels de recharge
Chacun des 3 modèles précédents répond à un modèle conceptuel particulier : EROS pour le modèle diffus-continu, GARDENIA pour le modèle épikarstique puis WATERSED pour le modèle d’infiltration concentrée préférentielle via les pertes. La performance des 3 modèles à équilibrer le bilan sera comparée. Nous testerons également si l’hypothèse d’une recharge des aquifères par la seule infiltration concentrée préférentielle via les pertes est réaliste ou pas en utilisant la base de données sur la capacité de ruissellement sur leurs bassins d’alimentation mise en place à l’issue du projet ANR FR MOTRHYSS (Patault et al. 2021 a,b,c, Maurié etal., 2023). Cette base de données comprend l’ensemble des pertes infiltrantes sur le secteur d’étude ainsi que les flux liquides et solides y entrants à l’échelle évènementielle et annuelle. Ces flux seront comparés aux lames d’eau supposément infiltrées engendrant la recharge des aquifères connues par les bilans hydrologiques à l’échelle des MESO.
T2 : Quel est le devenir de la recharge à l’aune de l’amélioration des connaissances sur les processus dans le cadre du changement global ?
T2.1 Evolution quantitative de la recharge des MESO pour les 3 modèles selon les modifications de la pluie efficace dans le cadre du changement climatique
Le CC va modifier la répartition des pluies ainsi que les températures, impactant l’évapotranspiration déterminant la pluie efficace. Cette dernière tombant sur des territoires avec une occupation des sols et un contexte hydogéomorphologique différents engendrera des modifications plus ou moins importantes de la recharge des aquifères. Nous utiliserons les hypothèses de modification de la recharge issus des travaux du GIEC et de leurs descentes d'échelle afin de projeter l’incidence sur la ressource en eau souterraine disponible à l’horizon 2050 sur le territoire des 7 MESO. Ces données seront utilisées pour alimenter les 3 modèles EROS, GARDENIA et WATERSED et ainsi projeter l’évolution de la recharge et des ressources en eau disponible dans les 7 MESO à l’horizon 2050. De plus, le modèle WATERSED permet de prendre en compte les pratiques culturales comme le calendrier d’occupation du sol et le type de culture. Aussi les projections sur les changements de pratiques agricoles issus de la chambre d’agriculture (besoin en irrigation, types de céréales, part de l’élevage) seront prises en considération et introduites dans le modèle WATERSED afin de déterminer l’évolution des flux liquides entrants dans les pertes en plus de l’augmentation des fréquences et des niveaux de retour des évènements extrêmes issus du CC.
T2.2 vulnérabilités de la ressource aux transferts hydrosédimentaires entre la surface et le souterrain
Les modèles couplés PREMACHE et WATERSED permettent de calculer des flux solides issus des ruissellements sur les parcelles engendrant un transfert hydrosédimentaire plus ou moins important en direction des pertes karstiques dont plusieurs centaines sont reconnues être en connexion hydraulique avec des captages d’alimentation en eau potable et ⅓ des captages de l’Eure et de la Seine-Maritime sont reconnus comme karstique. Aussi les projections sur les changements de pratiques agricoles issus de la chambre d’agriculture (calendrier cultural, types de cultures, pratique de labour) seront prises en considération et introduites dans le modèle WATERSED afin de déterminer l’évolution des flux solides entrants dans les pertes en plus de l’augmentation des fréquences et des niveaux de retour des évènements extrêmes issus du CC. Ces sorties de modèles PREMACHE-WATERSED constituent l’entrée du modèle d’IA par réseau de neurones pour prévoir les restitutions turbides au sein des captages. Actuellement, ces modèles sont utilisés séparément dans le cadre du projet PRIAME sur 3 captages pilotes. Les bons résultats nous motivent à coupler ces 3 modèles en une chaîne opérationnelle et optimisée pour multiplier les scénarii à l’échelle de tous les captages de l’Eure et de la Seine-Maritime (#350). De nouveaux modèles de réseau de neurones seront testés notamment les PNN qui ont deux principaux atouts. D’une part la possibilité de prendre en considération des données à l’échelle d’un secteur géographique en intégrant les proximités spatiales entre stations à modéliser et d’autre part de paramétrer les relations selon un contexte hydrogéomorphologiques. Ainsi, il sera pensé une architecture de modèles couplés PREMACHE-WATERSED-PNN à la fois unifiée à l’échelle des deux départements et spécifique selon la zone pédoclimatique, le degré de karstification, le type de MESO et les zones agricoles.
T3 : Quelle gestion des risques pour l’alimentation en eau potable ?
T3.1 : scénarii de gestion de la ressource en eau potable et des restrictions d’usage
Les 2 départements sont fortement touchés par les restrictions d’usage et chaque année entre une dizaine et plusieurs dizaines de milliers d’habitants subissent une période de restriction d’usage de l’eau potable avec des livraisons d’eau embouteillée suite à des pics de turbidité au captage d’eau potable. Une comparaison avec la base de données des flux hydrosédimentaires actuels disponibles via le projet ANR FR MOTRHYSS et les sorties de la chaîne de modèles PREMACHE-WATERSED-PNN sera réalisée pour projeter l’évolution du risque de restriction d’usage de l’alimentation en eau potable pour raison de turbidité dans le cadre du changement global sous différents scénarii de modifications des pratiques agricoles énoncés précédemment et de développement de stratégie de lutte contre les ruissellements sur les bassins versants (hydraulique douce, aménagement de perte, amélioration des techniques infiltrantes, bande enherbée, CIPAN, MAE). Ces scénarii d’impact du changement global sur les restrictions d’usage permettront d’envisager leur évolution pour 2050 et d’identifier les actions de lutte les plus performantes via des analyses de sensibilités des différents paramètres du modèle.
T3.2 : cartographie des zones à risques quantitatif et qualitatif
L’ensemble des travaux de la tâche T3.1 sera abordé de manière cartographique afin de développer une stratégie territoriale et de donner aux acteurs des instruments pour la mise en place d’une politique environnementale appliquée à leurs conditions et aux évolutions prévues dans le cadre du changement global.
Le travail de thèse portera donc sur l’amélioration des connaissances sur la nature de la recharge avec une implication sur la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau potable. Il devra aboutir au couplage des modèles PREMACHE-WATERSED-réseaux de neurones basés sur les conditions hydrogéomorphologiques développés dans les projets de recherche précédents (EVAPORE-MOTRHYSS-PRIAME). Ce couplage permettra de jouer des scénarii pour affiner les effets du changement global (climat+occupation du sol+pratiques agricoles) sur l’alimentation en eau potable des départements 27 et 76 à partir des captages exploitant la craie à l’horizon 2050.
Prise de fonction :
Nature du financement
Précisions sur le financement
Présentation établissement et labo d'accueil
L’Unité Mixte de Recherche (UMR) CNRS 6143 Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C) est un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée de 50 permanents (environ 90 personnes avec les doctorants, post-doctorants, etc.). Le laboratoire est présent sur deux sites géographiques, Caen et Rouen. Le laboratoire est membre de l’Observatoire Ecce Terra, de la Fédération de Recherche SCALE et du Centre de recherche en Environnement Côtier. Les domaines de compétences sont ceux des Géosciences et des Sciences de l’Environnement bâtis autour de personnels affiliés à 3 tutelles différentes (CNRS, Université de Caen Normandie et Université de Rouen Normandie). Les recherches du laboratoire M2C s’intéressent à la caractérisation et à la modélisation de la dynamique des processus naturels et des différents compartiments, le long du continuum Terre-Mer, à différentes échelles de temps et d’espace. Les recherches s’organisent en 3 thèmes, 2 questions transverses et des pôles de compétences. Ces recherches sont réalisées avec une approche interdisciplinaire intégrant des chercheurs spécialisés en géosciences, océanographie, hydrologie, mécanique, microbiologie et biologie des organismes. Les recherches couplent la mesure in situ, les approches expérimentales, la télédétection et la modélisation numérique.
Site web :
Intitulé du doctorat
Pays d'obtention du doctorat
Etablissement délivrant le doctorat
Ecole doctorale
Profil du candidat
Master ou Ingénieur en sciences de l’environnement, hydrologie, hydrogéologie avec un fort bagage en analyse des données et SIG
ou
Master ou ingénieur en mathématiques, sciences des données avec intérêt pour l’hydrologie
Pratique du codage R et Python
Formation interne assurée pour WaterSed, Eros et Gardenia
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Vous souhaitez recevoir nos infolettres ?
Découvrez nos adhérents
 ANRT
ANRT  CESI
CESI  Institut Sup'biotech de Paris
Institut Sup'biotech de Paris  ONERA - The French Aerospace Lab
ONERA - The French Aerospace Lab  PhDOOC
PhDOOC  SUEZ
SUEZ  ADEME
ADEME  MabDesign
MabDesign  CASDEN
CASDEN  Aérocentre, Pôle d'excellence régional
Aérocentre, Pôle d'excellence régional  Généthon
Généthon  ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège
ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège  TotalEnergies
TotalEnergies  MabDesign
MabDesign  Tecknowmetrix
Tecknowmetrix  Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE  Groupe AFNOR - Association française de normalisation
Groupe AFNOR - Association française de normalisation  Ifremer
Ifremer  Nokia Bell Labs France
Nokia Bell Labs France