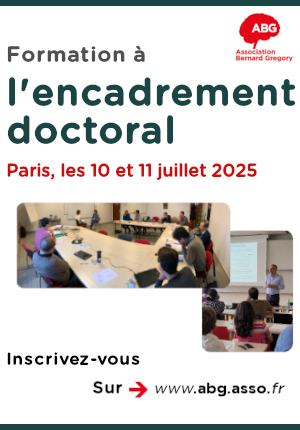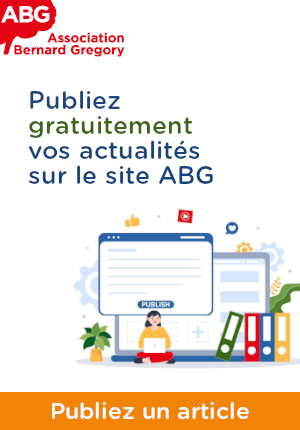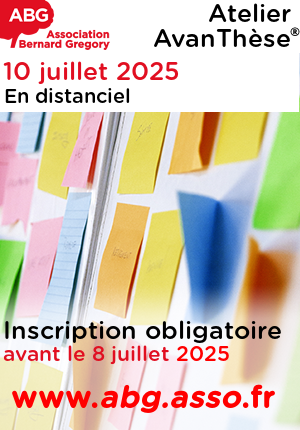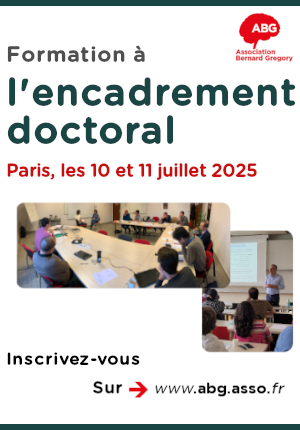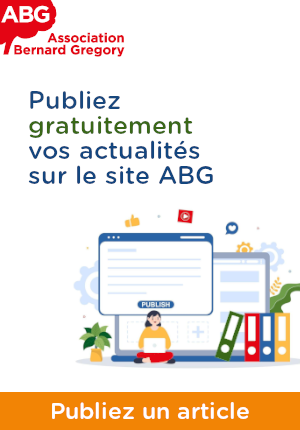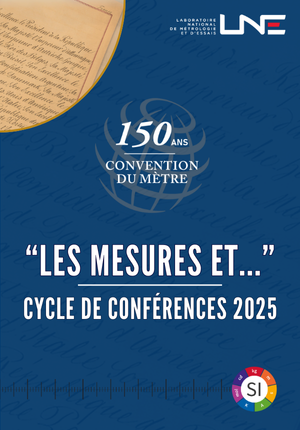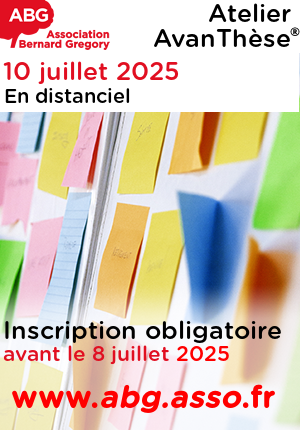Étude et modélisation de l’utilisation du carbone et de l’azote des matières organiques par les communautés microbiennes des sols des écosystèmes terrestres
| ABG-132040 | Sujet de Thèse | |
| 16/05/2025 | Contrat doctoral |
- Ecologie, environnement
Description du sujet
Nous recherchons un·e jeune scientifique motivé·e pour mener une thèse de doctorat en biogéochimie et modélisation, sur les processus de décomposition des matières organiques dans les sols. Ce doctorat a de fortes implications pour la mise en œuvre des pratiques de gestion des écosystèmes terrestres qui optimisent les services écosystémiques rendus par les matières organiques des sols (e.g., fertilité, atténuation des émissions de gaz à effet de serre, structuration des sols).
Contexte
Un des enjeux actuels est de mieux gérer les écosystèmes terrestres pour assurer leur productivité, tout en promouvant le stockage du carbone (C) dans les sols et la capacité du sol à fournir de l’azote (N) minéral de façon synchrone avec les besoins des végétaux.
Les microorganismes hétérotrophes des sols tirent leur énergie et les éléments nécessaires à leur croissance de la décomposition des matières organiques entrantes telles que les litières végétales. Cela se traduit par la minéralisation d’une partie du C sous forme de dioxyde de carbone (CO2) émise vers l’atmosphère, l’autre partie est assimilée dans les corps microbiens. Les produits de ces processus peuvent être inclus dans les agrégats et/ou adsorbés sur les surfaces minérales du sol, contribuant à la stabilisation du C. L’activité des microorganismes hétérotrophes agit directement sur les cycles des nutriments, tel que N dont la dégradation est associée à celle du C. Les flux de N dépendent de la richesse relative de cet élément dans les matières organiques et dans les microorganismes, ainsi que la richesse du sol. La décomposition peut entraîner une fourniture nette de N minéral ou une diminution temporaire des teneurs en N du sol, appelée immobilisation, car les communautés microbiennes le prélèvent pour leur besoin.
Ces processus ont été étudiés - et des modèles calibrés - dans des contextes où les sols étaient assez souvent fortement fertilisés. Cependant, l’adoption de pratiques agroécologiques s’accompagne d’une diminution de la fertilisation minérale, d’une augmentation des restitutions de litières, l’introduction de légumineuses et d’apport organique qui modifient la richesse du milieu, façonnant l’héritage microbien des communautés microbiennes. Le premier objectif de ce doctorat est de caractériser expérimentalement les processus microbiens d’utilisation du C et du N issus de la décomposition des matières organiques dans les sols d’écosystèmes terrestres pour lesquels des pratiques agroécologiques ont été mises en place. A partir des données acquises, le second objectif est la révision des formalismes et la simulation de ces processus avec un modèle mécaniste, afin de l’adapter au contexte de la réduction de la richesse du sol en N et le calibrer.
L’amélioration de la compréhension des processus et de la représentation des flux de C et N des matières organiques est cruciale pour adapter les outils de simulation, de prédiction et d’aide à la décision des pratiques de gestion des écosystèmes terrestres et de leurs impacts agronomiques et environnementaux.
Ce doctorat s’inscrit dans le projet de recherche CANETE, financé par l’ANR pour 5 ans (2023-2028) dans le cadre du Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) FairCarboN. L’objectif scientifique de CANETE est d'évaluer et de prédire les réponses physiologiques microbiennes aux pratiques de gestion de la nutrition azotée des écosystèmes terrestres et leurs conséquences sur le stockage de C dans le sol, la fourniture en N aux plantes et la production végétale. CANETE rassemble un consortium composé de 16 laboratoires et de 9 sites expérimentaux. Ces sites incluent des systèmes de cultures annuelles, des prairies et des forêts.
Méthodologie
La méthodologie s’appuie sur un volet expérimental et un volet de modélisation afin d’intégrer les nouvelles connaissances acquises en révisant un modèle mécaniste (CANTIS).
Pour le volet expérimental, le·la doctorant·e mènera des incubations dans des conditions contrôlées en utilisant une sélection de sols étudiés dans le projet CANETE et des litières végétales. Les sols seront prélevés dans plusieurs écosystèmes avec des quantités et formes de N contrastées. Des litières végétales marquées avec des isotopes stables (13C-15N) seront utilisées afin de suivre finement la dynamique de dépolymérisation des substrats, leur assimilation microbienne, la libération de N minéral et la respiration. La fraction soluble des litières et des sols sera quantifiée et caractérisée (pyrolyse-GC-MS et RMN 13C). Ces données seront mises en relation avec des caractérisations de la diversité fonctionnelle des communautés microbiennes acquises par les collaborateurs du projet.
Pour le volet modélisation, le·la doctorant·e confrontera les simulations du modèle CANTIS avec les données acquises pendant l’expérimentation sur la décomposition des litières. Le·la doctorant·e proposera une révision du formalisme et de la calibration du modèle et une adaptation de ce dernier aux situations limitantes en N. Pour cela, il·elle synthétisera les informations existantes sur les représentations microbiennes explicites dans des cadres conceptuels, intégrera les dires d’experts et les résultats expérimentaux acquis. Des analyses de sensibilité seront effectuées pour générer une hiérarchie des paramètres influents du modèle et propager la variabilité des paramètres mesurés. Le modèle révisé pourra être évalué sur les données acquises dans le cadre du projet CANETE sur l’ensemble des sites et sur une compilation de jeux de données indépendants.
Prise de fonction :
Nature du financement
Précisions sur le financement
Présentation établissement et labo d'accueil
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur majeur de la recherche et de l’innovation. L’institut rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 273 unités de recherche, de service et d’expérimentation implantées dans 18 centres sur toute la France.
Institut de recherche finalisée, il se positionne parmi les tout premiers organismes de recherche au monde en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et en écologie-environnement. Il est le premier organisme de recherche mondial spécialisé sur l’ensemble « agriculture-alimentation-environnement » INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux.
Face à l’augmentation de la population et au défi de la sécurité alimentaire, au dérèglement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut a rôle un majeur pour construire des solutions et accompagner la nécessaire accélération des transitions agricoles, alimentaires et environnementales.
Vous serez travaillerez dans l'Unité mixte de recherche Fractionnement des AgroRessources et Environnement (FARE) située à Reims (51100) qui compte environ 30 agents permanents. Cette unité rassemble des personnels d’INRAE et de l’Université Reims Champagne Ardenne (URCA). Elle est spécialiste des biomasses végétales et de leurs transformations.
Adresse du laboratoire d’accueil
UMR FARE, CREA, 2 esplanade Roland Garros, 51100 Reims, https://fare.nancy.hub.inrae.fr/
Des missions dans le laboratoire METIS à Paris seront organisées, ainsi qu’un séjour à l’étranger dans les laboratoires partenaires du projet CANETE en Europe.
Encadrement académique
Directrice de Thèse : Gwenaëlle LASHERMES, INRAE, FARE (gwenaelle.lashermes@inrae.fr)
Co-encadrant·e·s :
- Marie Alexis, Sorbonne Université, METIS (marie.alexis@sorbonne-universite.fr)
- Hugues Clivot, URCA, FARE (hugues.clivot@univ-reims.fr)
- Ali Faraj, INRAE, FARE (ali.faraj@inrae.fr)
Site web :
Intitulé du doctorat
Pays d'obtention du doctorat
Etablissement délivrant le doctorat
Profil du candidat
Le·la candidat·e sera titulaire d’un diplôme de Master ou équivalent et possédera des compétences en biogéochimie et/ou écologie microbienne et modélisation, il·elle présentera avec un intérêt fort pour les questions scientifiques de ce projet. Il·elle aura, a minima, un goût pour la modélisation et/ou le travail d'expérimentation en laboratoire, et une première expérience dans l'un des deux domaines sera très appréciée.
Rigueur et organisation, écoute, capacité à collaborer dans une équipe pluridisciplinaire, à s’intégrer rapidement dans des collectifs de recherche, à rendre compte des résultats et à les communiquer, sont des compétences nécessaires pour réaliser ce doctorat.
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Vous souhaitez recevoir nos infolettres ?
Découvrez nos adhérents
 ADEME
ADEME  Généthon
Généthon  CASDEN
CASDEN  ONERA - The French Aerospace Lab
ONERA - The French Aerospace Lab  MabDesign
MabDesign  SUEZ
SUEZ  TotalEnergies
TotalEnergies  ANRT
ANRT  Nokia Bell Labs France
Nokia Bell Labs France  Groupe AFNOR - Association française de normalisation
Groupe AFNOR - Association française de normalisation  Tecknowmetrix
Tecknowmetrix  ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège
ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège  Aérocentre, Pôle d'excellence régional
Aérocentre, Pôle d'excellence régional  MabDesign
MabDesign  Institut Sup'biotech de Paris
Institut Sup'biotech de Paris  Ifremer
Ifremer  PhDOOC
PhDOOC  Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE  CESI
CESI