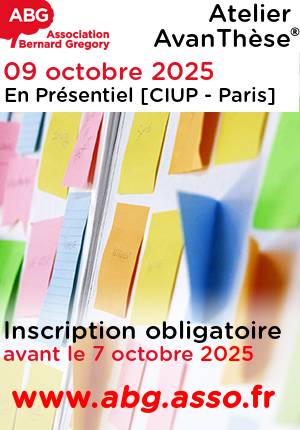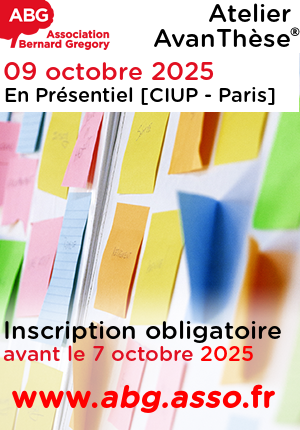ENDOMMAGEMENT INDUIT PAR LA FRAGILISATION PAR HYDROGENE (EIFH)
| ABG-133268 | Sujet de Thèse | |
| 01/09/2025 | Contrat doctoral |
- Sciences de l’ingénieur
- Matériaux
Description du sujet
Contexte du projet et historique de collaborations
L’Université Internationale de Rabat (UIR) et l’Université de Lorraine (UL) ont récemment entamé une collaboration de recherche scientifique dans le domaine de l'énergie et de l'efficacité énergétique. A l’occasion de la réunion organisée le 5 Novembre 2019, pour la signature d’une convention cadre entre les deux universités, les équipes participantes ont montré l’intérêt de consolider la collaboration existante au niveau pédagogique et la mise en place d’une nouvelle collaboration en recherche dans le domaine des matériaux biosourcés, de l’intégration des énergies renouvelables dans des systèmes énergétiques décentralisés ou off-grid, les matériaux pour l’énergie conversion & stockage, la biomasse, l’efficacité énergétique, le bâtiment intelligent et l’hydrogène. Ce projet de recherche rentre parfaitement dans le cadre de cet accord de collaboration entre les deux universités et vise à promouvoir et à renforcer les coopérations et les échanges entre les équipes participantes des deux universités, notamment dans le domaine du développement de nouveaux matériaux avancés partiellement ou entièrement biosourcés pour applications innovantes et écologiques. Plus précisément, ce projet a pour ambition de contribuer à la caractérisation et la prédiction de l’effet de l’exposition de matériaux métalliques à l’hydrogène qui peut entrainer leur fragilisation pour des applications qui perdurent.
Motivation de la collaboration
La collaboration UIR – UL sera mise en œuvre sur la base de l’expérience et de l’expertise des deux équipes impliquées dans le domaine traité. Les deux équipes ont des compétences et expertises dans des thématiques de recherche complémentaires et indispensables pour la réussite de ce projet de recherche. Sachant que celles-ci interagiront sur l’ensemble des aspects scientifiques notamment en termes de modélisation, de simulation numérique et de caractérisation expérimentale.
Le LEM3 est une unité mixte de recherche (UMR) rattachée à l’Université de Lorraine, au CNRS et aux Arts et Métiers. Le LEM3 regroupe environ 250 personnes dont 150 personnels permanents (11 chercheurs, 105 enseignants-chercheurs, 45 personnels administratifs et techniques) et plus de 80 doctorants et post-doctorants.
Le laboratoire des énergies renouvelables et matériaux LERMA est formé par 34 enseignants-chercheurs, 6 postdocs et 50 doctorants. Il dispose de dispositifs classiques de caractérisation mécanique (Machine de traction Tinios 50KN, Mouton de Charpy, Mesure de dureté (indenteur), Machine de fatigue mécanique et barre de Hopkinson) et thermique (banc de mesure de conductivité thermique), de moyens d’investigations du comportement hydrique (étuve à humidité contrôlée, balance précise) et d’extraction des fibres. En matière de logiciels de calcul, LERMA dispose ComsolMultiphysics, Abaqus, Cast3m et Fluent Ansys pouvant servir dans le calcul de structures, de résolution des problèmes multiphysiques et de l’énergétique. Ainsi, l’équipe du LERMA de l’Université Internationale de Rabat (Maroc) travailleront sur une modélisation multi-échelles du phénomène de fragilisation de leur réponse thermo-hygro-mécanique. Elle s’occupera profondément du développement et de l’implémentation d’outils numériques sophistiqués basés sur des modèles micro-macro.
Notre proposition se focalise sur la mise en œuvre d'un contrat doctoral en cotutelle de 2025 à 2028, avec pour objectif principal de réaliser des travaux scientifiques sur une thématique liée à la sécurité du transport d’hydrogène (le déroulé de la thèse est présenté en Annexe 1). Les travaux de thèse décrits permettront aux deux équipes de monter en compétences, sur des aspects expérimentaux et numériques, sur cette thématique favorisée par les stratégies nationales, et de les partager. Ils permettront d’envisager ensuite de plus larges études (industrielles et/ou à plus longs termes) par l’intermédiaire de futurs dépôts de projets en commun avec des partenaires comme Air Liquide, Vallourec, etc… Les deux équipes utiliseront des outils de travail collaboratif à distance pour travailler en commun sur les différents aspects du projet et assurer son pilotage et le co-encadrement du doctorant impliqué.
Objectifs et Etat de l’art
L’idée du présent projet est de caractériser expérimentalement et numériquement la tenue mécanique des aciers dans un milieu hydrogéné et d’en prédire la fragilisation ainsi causée de ces derniers. En effet, l’hydrogène est l’élément chimique le plus simple (un proton et un électron), le plus léger, mais également le plus abondant dans l’univers où il compose environ 75 % de sa masse totale. Il suscite de nombreux espoirs partout dans le monde. La France débloquera 7 milliards d’euros en faveur de la filière hydrogène d’ici 2030, dont 2 milliards intégrés dans le plan de relance. Que ce soit pour l’aérien, le ferroviaire, les camions ou les véhicules légers, l’hydrogène apparaît pour certains comme l’alternative rêvée au diesel ou au kérosène. Si l’hydrogène est encore produit à partir de gaz fossile, la France s’est engagée à décarboner progressivement cette production et à atteindre entre 20 et 40 % à horizon 2030 d’hydrogène vert. En effet, le seul sous-produit de la combustion du mélange hydrogène H2 / air comburant contenant de l’oxygène, est de la vapeur d’eau (pas de CO2, pas de NOx si la combustion est bien gérée). De plus, le pouvoir calorifique de l’hydrogène est particulièrement élevé : 119 MJ/kg en PCI, contre 49 MJ/kg (PCI) pour le butane et 50 MJ/kg PCI pour le gaz naturel.
Production de l’hydrogène
A l’heure actuelle, il est principalement issu de la pétrochimie par vaporeformage du méthane (CH4). Dans le futur, l’électrolyse de l’eau (décomposition de H20 avec de l’électricité) semble être une solution plus vertueuse en particulier à partir d’électricité verte (photovoltaïque, éolien, …). Le Réseau Transport Electricité estime que l’hydrogène, vers 2035, pourrait offrir de la flexibilité au réseau électrique en permettant de stocker (sous forme de gaz) l’électricité produite lors des pics de production. Il existe également des sources d’hydrogène naturel diffus (fond des océans, flammèche, …) en faible quantité et difficilement récupérable de manière industrielle. Ces sources sont cependant encore peu connues et étudiées. L’hydrogène pourrait être également produit à partir de la biomasse agricole (déchets de chanvre, orties, …) par pyro-gazéification. Selon une étude européenne récente, près de 75 % des réseaux seraient en capacité de s’adapter pour accueillir de l’hydrogène. Des chaudières à hydrogène pour des collectivités sont déjà en tests. L’hydrogène pourrait être injecté dans les réseaux de gaz qui deviendraient alors à la fois un lieu de stockage d’énergie et un facteur de flexibilité pour l’ensemble du système énergétique permettant de transformer en gaz les surplus d’électricité issues des énergies renouvelables (solaire, éolien) difficilement pilotables. Ce concept appelé « power-to-gaz » permettrait ainsi de créer des passerelles entre les réseaux d’électricité et ceux de gaz naturel. Même si l’hydrogène ne peut actuellement être injecté qu’en quantité limitée (20 %) dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel pour des raisons de sécurité, de risques de fuites, de compatibilité avec les utilisateurs finaux ou de compatibilité avec les conduites, cette possibilité donnerait accès aux très grandes capacités de transport et de stockage des réseaux de gaz. En France, les capacités de stockage des réseaux de gaz sont 300 fois plus importantes que celles du système électrique (137 TWh contre 0,4 TWh).
Aspects expérimentaux de l’endommagement par l’hydrogène
 Interactions hydrogène-métal
Interactions hydrogène-métal
L’hydrogène, du fait de sa petite taille atomique, peut être facilement absorbé et peut diffuser en profondeur dans un réseau métallique cristallin beaucoup plus facilement que n’importe quel autre atome en solution solide. Lorsque la source d’hydrogène affecte une microstructure sous contraintes ou présentant des ségrégations, les interactions hydrogène/métal peuvent conduire à la fragilisation par l’hydrogène du métal et à une fissuration fragile. Il est également susceptible de prendre des chemins déviés, des « courts-circuits » de diffusion qui lui permettent de pénétrer plus profondément dans l’alliage. Il peut notamment y avoir diffusion le long des joints de grains ou encore à travers les réseaux de dislocations. Des travaux récents ont confirmé l’existence de fortes énergies de liaison entre l’hydrogène et les dislocations. Par ailleurs, en plus de faciliter l’émission des dislocations, l’hydrogène accroît fortement leur mobilité. Certains modèles prédisent également un transport de l’hydrogène par ces mêmes dislocations, en facilitant la diffusion. Les alliages métalliques soumis à de grandes quantités d’hydrogène piégé ou diffusant sont soumis à la Fragilisation Assistée par Hydrogène (FAH). Cela entraîne l’apparition de divers mécanismes pouvant entraîner, une fissuration, la formation d’hydrures ainsi qu’une diminution des propriétés mécaniques, une perte de ductilité ainsi qu’une fragilisation du matériau.
- Mécanismes de fragilisation du métal
L’hydrogène peut affaiblir le métal selon plusieurs mécanismes : l’affaiblissement des liaisons entre atomes, la diminution de la ductilité ou encore la formation de phases fragiles. Tout d’abord, on peut avoir un affaiblissement des liaisons entre les atomes. En effet, les atomes d’hydrogène, en se glissant entre les atomes de métal (site interstitiel), diminueraient la résistance à la rupture du métal. Ce mécanisme nécessite une concentration importante en hydrogène. On soupçonne ce mécanisme d’être en action essentiellement pour les alliages à haute résistance. Ensuite, on constate une diminution de la ductilité car les atomes d’hydrogène peuvent interagir avec les dislocations et donc modifier la capacité à la déformation plastique.
- Diminution de la tenue en fatigue des aciers par l’hydrogène
 Un autre problème est lorsque la source d’hydrogène affecte une microstructure sous contraintes ou présentant des ségrégations, les interactions hydrogène/métal peuvent conduire à la fragilisation du métal et à une fissuration fragile. (Affaiblissement des liaisons entre atomes, diminution de la ductilité ou encore formation de phases fragiles)
Un autre problème est lorsque la source d’hydrogène affecte une microstructure sous contraintes ou présentant des ségrégations, les interactions hydrogène/métal peuvent conduire à la fragilisation du métal et à une fissuration fragile. (Affaiblissement des liaisons entre atomes, diminution de la ductilité ou encore formation de phases fragiles)
Pendant le contrat Européen NaturalHy, l’équipe UL a pu montrer une diminution de la tenue en fatigue agissant sur l’étape d’amorçage mais également sur l’étape de propagation. Les effets de l’hydrogène sur la déformation, l’endommagement et la rupture des métaux et alliages de structures sont multiples.
 Il diminue dans le métal la tenue en fatigue en agissant sur l’étape d’amorçage mais également sur l’étape de propagation. L’hydrogène agit tout d’abord sur l’étape d’amorçage, en localisant le défaut critique et en limitant ainsi les fissures secondaires lorsque la concentration d’hydrogène est suffisamment importante. D’autre part, la propagation de la fissure longue est favorisée par l’hydrogène et la vitesse de propagation des fissures est influencée directement par la pression partielle d’hydrogène.
Il diminue dans le métal la tenue en fatigue en agissant sur l’étape d’amorçage mais également sur l’étape de propagation. L’hydrogène agit tout d’abord sur l’étape d’amorçage, en localisant le défaut critique et en limitant ainsi les fissures secondaires lorsque la concentration d’hydrogène est suffisamment importante. D’autre part, la propagation de la fissure longue est favorisée par l’hydrogène et la vitesse de propagation des fissures est influencée directement par la pression partielle d’hydrogène.
- Vulnérabilité des aciers à haute résistance mécanique
Au fur et à mesure que la résistance des aciers augmente, leur vulnérabilité à la fragilisation par l’hydrogène augmente également. Dans les aciers à haute résistance, toutes les nuances qui dépassent une dureté de HV 390 peuvent être sensibles au craquage précoce de l’hydrogène après des processus de placage qui introduisent de l’hydrogène.
Solution à la fragilisation par l’hydrogène
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle génération d’aciers durcis par précipitation qui rivalisent avec les aciers durcis par martensite avec des propriétés mécaniques équivalentes ou plus élevées à température ambiante et à hautes températures avec le bonus d’être moins susceptibles à la fragilisation par hydrogène. Leur seul inconvénient est le coût puisque ce sont des aciers fortement alliés à bas carbone dont la composition chimique doit être très contrôlée. Ces aciers sont utilisés aujourd’hui dans l’industrie aéronautique pour certaines pièces critiques des trains d’atterrissage et pour les arbres de turbines. Mais, pour l’industrie qui veut utiliser l’hydrogène comme combustible, ce paramètre deviendrait peut-être un détail. On aurait alors de bonnes nouvelles pour elle.
L’objectif du projet est d’étudier et de comparer la durée de vie de différents aciers, de limites d’élasticité comprises entre 360 et 700MPa (nuances API 5L X65, X70 et X100), face à la présence de l’hydrogène, contenu dans une solution électrolytique NS4 et sous forme gazeuse. Pour ce faire, afin de simuler les cycles réguliers de remise en pression dans les pipelines, le chargement en hydrogène électrolytique ou gazeux sera combiné à des essais de fatigue « traction-traction » avec des éprouvettes cylindriques obtenues par usinage dans l'épaisseur du pipeline, dans le sens longitudinal de ce dernier. L’endommagement causé par la fragilisation par hydrogène sera ensuite modélisé sur un niveau multi échelle, en adoptant une approche « Top-down ». L’approche « Top-down » nécessite le développement du modèle macroscopique allant jusqu’à l’échelle atomique, afin de mieux comprendre le comportement des matériaux et ensuite prédire leur performance. La méthode de fragilisation sous hydrogène électrolytique est bien connue et maitrisée au niveau de l’équipe UL engagée dans le projet [5 à 8].
Aspects modélisation de l’endommagement par l’hydrogène
Outre les méthodes d'essai expérimentales, la plupart des tentatives de modélisation de la rupture assistée par l'hydrogène se sont concentrées sur des modèles de fissures discrètes, même si ces modèles sont limités lorsqu'il s'agit conditions de chargement complexes liés aux applications réelles et surtout quand il s’agit de fractures en mode mixte, fissures en interaction, etc. Pour pallier les insuffisances des modèles de fissures discrètes, les problèmes de fragilisation par l'hydrogène ont récemment fait l'objet d'un examen approfondi. En effet, l'utilisation de modèles de fissures étalées, tels que les modèles d'endommagement continu, comme la méthode du champ de phase (PF) ont vu le jour [1,2] et la péridynamique (PD) [3,4]. Ces deux méthodes représentent la fracture comme un continuum avec des capacités de charge négligeables ou nulles, et le développement des fissures est suivi implicitement par des variables d'endommagement obtenues en résolvant les équations gouvernantes qui les régissent. Elles constituent une alternative efficace pour traiter les problèmes de fracture, car aucun critère ad hoc supplémentaire n'est nécessaire pour régir l'amorçage/la propagation des fissures. En outre, il n'y a pas de restrictions géométriques sur la forme/taille de la fissure et son initiation peut se produire à partir de fissures préexistantes dans le volume ou les limites et la surface lisse.
Prise de fonction :
Nature du financement
Précisions sur le financement
Présentation établissement et labo d'accueil
Thèse en co-tutelle avec l'’Université Internationale de Rabat (UIR) au Maroc, l'Ecolé Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM) intégrée au sein de l'Université de Lorraine (UL) et du Laboratoire d’Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3).
Site web :
Intitulé du doctorat
Pays d'obtention du doctorat
Etablissement délivrant le doctorat
Ecole doctorale
Thèse en cotutelle
OuiPays d'obtention du doctorat en cotutelle
Etablissement délivrant le doctorat en cotutelle
Profil du candidat
Autonomie
Experimental
Force de proposition
Bon niveau d'anglais
Solides bases en mécanique/matériaux
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Vous souhaitez recevoir nos infolettres ?
Découvrez nos adhérents
 PhDOOC
PhDOOC  ANRT
ANRT  MabDesign
MabDesign  Généthon
Généthon  TotalEnergies
TotalEnergies  Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE  CESI
CESI  CASDEN
CASDEN  Nokia Bell Labs France
Nokia Bell Labs France  Groupe AFNOR - Association française de normalisation
Groupe AFNOR - Association française de normalisation  Ifremer
Ifremer  ONERA - The French Aerospace Lab
ONERA - The French Aerospace Lab  Institut Sup'biotech de Paris
Institut Sup'biotech de Paris  SUEZ
SUEZ  ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège
ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège  Aérocentre, Pôle d'excellence régional
Aérocentre, Pôle d'excellence régional  ADEME
ADEME  Tecknowmetrix
Tecknowmetrix  MabDesign
MabDesign