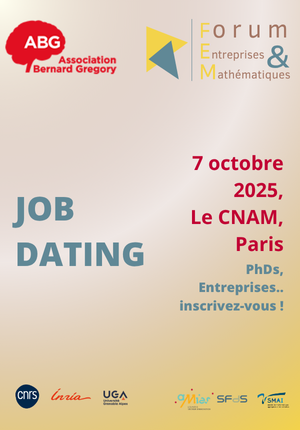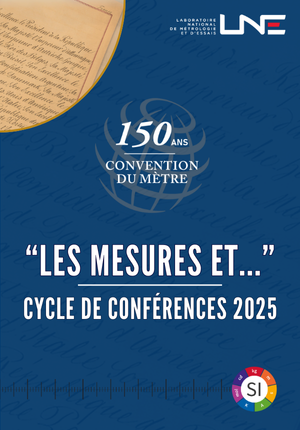Adaptation neuronale après lésion de la moelle cervicale et stimulation synchronisée comme approche thérapeutique pour prévenir l'atrophie du diaphragme
| ABG-132767 | Sujet de Thèse | |
| 03/07/2025 | Autre financement public |
- Santé, médecine humaine, vétérinaire
Description du sujet
Les lésions de la moelle épinière (LME) comptent parmi les plus dévastatrices qu'un individu puisse subir, touchant plus de 2,5 millions de personnes dans le monde. Parmi les LME, 60 % se situent au niveau cervical, entraînant une paralysie locomotrice, mais aussi une altération importante de la capacité respiratoire. Les lésions situées haut dans la colonne vertébrale (C4 ou au-dessus) peuvent rendre les survivants dépendants de la ventilation mécanique, avec de multiples conséquences en termes de qualité de vie et de mortalité accrue. Aujourd'hui, pour les patients incapables de respirer spontanément, la ventilation mécanique (VM) est la seule solution. Cependant, la VM aggrave les altérations de la fonction diaphragmatique et réduit les chances de récupération respiratoire.
Récemment, le Dr Isabelle Vivodtzev (CR Insem à l'équipe Near, Dev2A, IBPS, Sorbonne Université, Jussieu, Paris) a développé un nouveau système de stimulation non invasive des muscles extra-diaphragmatiques (muscles intercostaux et abdominaux) synchronisée avec la respiration (rSynES). Les résultats préliminaires suggèrent que le diaphragme et la fonction respiratoire se rétablissent suite à cette stimulation indirecte du diaphragme. Cette découverte suggère fortement que les réseaux neuronaux spinaux pourraient être activés et qu'une régénération/un bourgeonnement axonal pourrait se produire. Cette évolution serait d'un grand intérêt pour les patients actuellement dépendants de la VM. Cependant, les mécanismes d'action ne sont pas encore compris. Ceci peut être réalisé en testant les effets longitudinaux de rSynES sur un modèle murin de lésion médullaire cervicale et en évaluant les adaptations moléculaires et cellulaires au fil du temps par IRM de moelle épinière de petits animaux.
Le Dr Julien Flament a développé une expertise unique en IRM-CEST du glutamate (gluCEST), une modalité récemment développée pour permettre l'imagerie in vivo du glutamate. Cette modalité d'imagerie non invasive peut être appliquée sur n'importe quel scanner IRM car elle ne nécessite qu'une séquence IRM spécifique, déjà disponible en laboratoire. L'équipe de Julien Flament a déjà tracé des cartes anatomiques gluCEST de la moelle épinière bien résolues, dont gluCEST pourrait jouer un rôle crucial dans notre étude en fournissant des informations précieuses sur l'intégrité des neurones et la localisation des défauts énergétiques au site de la lésion, dans la région rostro-caudale et après rSynEs.
Dans le cadre de ce projet, des approches standardisées seront utilisées pour étudier la fonction respiratoire et l'EMG diaphragmatique après une lésion médullaire cervicale et un traitement par rSynES (avec Isabelle Vivodtzev, Jussieu, Paris), ainsi que des analyses structurales et moléculaires et une IRM métabolique de pointe de la moelle épinière (avec Julien Flament, co-directeur de thèse au CEA-MIRCen).
Nous utiliserons notamment un modèle murin préclinique d'hémi-contusion C3 (C3HC ou laminectomie), développé en laboratoire car il reproduit les lésions cervicales traumatiques chez l'homme (réduction de 46 % de l'activité diaphragmatique et perte de 25 % de la fonction respiratoire)1. Les contusions unilatérales permettent des études longitudinales de l'activation neuronale et des processus régénératifs. La fonction respiratoire sera évaluée à différents moments avant/après une lésion médullaire cervicale et un traitement par rSynES par pléthysmographie de flux corps entier pendant la respiration spontanée ou l'hypercapnie. L'activité diaphragmatique sera surveillée par des enregistrements électrophysiologiques. IRM-CEST du glutamate (gluCEST). La séquence GluCEST disponible pour l'imagerie de la moelle épinière (11,7 T, cryosonde haute performance) sera réalisée à trois moments précis afin d'établir des cartes médullaires précises des concentrations de glutamate. Ces cartes gluCEST fourniront un biomarqueur pertinent de l'intégrité neuronale et cartographieront les sites de défauts énergétiques avant et après rSynES dans le modèle de lésion médullaire C3. La plasticité et la survie des motoneurones, ainsi que leur bourgeonnement, seront évaluées en fonction de l'expression de marqueurs synaptiques fonctionnels (synaptophysine, VGlut1, VGlut2) ; des voies descendantes, des fibres 5HT, du traçage des axones des AAV du tractus supraspinal (ou BDA) et de l'altération de l'expression des gènes BDNF, TrkB et Akt. L'inflammation sera évaluée par immunomarquage et Western blots. Ce projet bénéficiera de la vaste expertise des deux laboratoires en neuroplasticité/physiologie respiratoire et en imagerie CEST-IRM. En effet, la plupart des séquences IRM ont déjà été développées et validées. Une part importante du projet consistera à programmer et à développer un outil avancé d'analyse du signal CEST afin de rendre la méthode d'imagerie spécifique et quantitative.
Le/La candidat(e) sera en mesure de prendre rapidement en main ces outils, un outil de quantification ayant déjà été développé pour une autre application par un(e) précédent(e) doctorant(e). Ce projet devrait fournir un nouvel outil non invasif à la communauté préclinique pour évaluer le glutamate comme biomarqueur potentiel de l'intégrité neuronale et identifier la localisation des défauts énergétiques le long de la moelle épinière.
Une part importante de sa thèse sera réalisée au Centre de Recherche en Imagerie Moléculaire MIRCen-CEA, situé à Fontenay-aux-Roses, un centre multidisciplinaire situé à l'interface entre la physique et la biologie. Par conséquent, le/la candidat(e) devra démontrer des compétences et un intérêt marqué pour ces deux disciplines. De plus, il/elle devra démontrer une aptitude au traitement de données et à la simulation numérique. La maîtrise des outils de programmation (Matlab, Python, C++) est essentielle, et la connaissance de la RMN/IRM serait un atout précieux.
Résultats attendus
Ce travail interdisciplinaire, qui s'appuie sur des thématiques fortes de l'unité Near Team (neuroplasticité et adaptation après lésion médullaire et traitements) et du CEA (méthodologie RMN avancée, simulations numériques, modélisation, neurosciences), devrait démontrer l'intérêt de l'utilisation des rSynEs comme option thérapeutique pour les patients atteints de lésion médullaire cervicale et sous VM.
Nous viserons à démontrer l'efficacité des rSynEs extra-diaphragmatiques grâce à l'IRM, en parallèle avec des approches d'évaluation bien connues de la plasticité motoneuronale et de la réponse inflammatoire médullaire. De plus, nous étudierons si l'IRM peut fournir de nouveaux biomarqueurs de la neuroplasticité permettant de détecter avec précision les changements après lésion médullaire, mais aussi les effets des interventions.
Prise de fonction :
Nature du financement
Précisions sur le financement
Présentation établissement et labo d'accueil
Deux lieux différents seront nécessaires pour ce projet multidisciplinaire :
Les première et troisième années du doctorat se dérouleront au laboratoire Near Team, unité Dev2A, IBPS, 7-9 quai Saint-Bernard, Bâtiment Bar Cassan, Jussieu, 75005 Paris.
Compétences d'apprentissage :
Année 1 : Modèle de lésion médullaire, tests de stimulation, mesures respiratoires, perfusion et extraction tissulaire.
Année 3 : Histologie et immunomarquage, analyses Western blot.
Deuxième année : CEA/DRF/Institut de Biologie François Jacob, Service MIRCen, Laboratoire des Maladies Neurodégénératives, Centre : Fontenay-aux-Roses.
Compétences d'apprentissage :
Année 2 : Acquisition de données CEST-IRM, programmation MATLAB, quantification du glutamate.
Intitulé du doctorat
Pays d'obtention du doctorat
Etablissement délivrant le doctorat
Ecole doctorale
Profil du candidat
Master 2 Neurosciences / Physiologie avec une orientation imagerie et programmation
ou
École d'ingénieur ou Master (Informatique / Programmation / Génie biologique / Imagerie médicale / Biophysique) avec une orientation neurosciences / physiologie respiratoire
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Vous souhaitez recevoir nos infolettres ?
Découvrez nos adhérents
 MabDesign
MabDesign  SUEZ
SUEZ  Nokia Bell Labs France
Nokia Bell Labs France  Tecknowmetrix
Tecknowmetrix  ANRT
ANRT  CASDEN
CASDEN  Ifremer
Ifremer  TotalEnergies
TotalEnergies  Groupe AFNOR - Association française de normalisation
Groupe AFNOR - Association française de normalisation  MabDesign
MabDesign  Institut Sup'biotech de Paris
Institut Sup'biotech de Paris  Généthon
Généthon  CESI
CESI  ONERA - The French Aerospace Lab
ONERA - The French Aerospace Lab  ADEME
ADEME  Aérocentre, Pôle d'excellence régional
Aérocentre, Pôle d'excellence régional  ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège
ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège  PhDOOC
PhDOOC  Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE